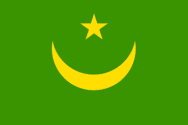
|
République islamique de la mauritanie | 
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situation et climat La République Islamique de Mauritanie couvre une superficie de 1 025 520 km2 (dont 394 580 km2 à vocation agricole). Limitrophe du Sénégal au sud, du Mali à l'est et au sud-est, de l'Algérie au nord-est, du Sahara Occidental au nord-ouest et de l'Océan Atlantique à l'ouest, elle fait la jonction entre le Maghreb Arabe et l'Afrique Noire. La Mauritanie est un pays très aride avec un relief très diversifié qui comprend, selon les régions, des plateaux, des dunes de sable et des plaines. Trois zones éco-climatiques peuvent être différenciées :
Population La population totale était estimée à 2 568 000 habitants en 1999 avec un taux moyen de croissance démographique de 2,82 % entre 1990 et 1999 (voir carte). En 1995, la population agricole représentait 46 % de la population totale. Les cycles successifs de sécheresse entre 1977 et 1984 et l'attraction de la ville ont modifié l'organisation sociale, avec une réduction de la population nomade (33,2 à 21,6 %), et une augmentation des sédentaires ruraux (44,1 à 49,3 %) et des citadins (27,7 à 29,1 %). Considérant les critères de pauvreté adoptés par la Banque Mondiale en 1990, 45 % de la population mauritanienne vivait, en 1995, sous le seuil d'extrême pauvreté (moyenne des dépenses inférieures à 275 US$ par an et par personne). Économie Classée parmi les pays les moins avancés (PMA), l'économie mauritanienne subit depuis les années 70 les effets négatifs et combinés des cycles périodiques de sécheresse et de la baisse sur le marché international des prix du fer, qui font fluctuer depuis lors le taux de croissance du PIB. Celui-ci était néanmoins de 4,9 % en 1995 et de 3,5 % en 1998. En 1997, les importations totales étaient de 355 millions US$ et les exportations totales de 413 millions US$. En 1994, les importations de produits agricoles étaient de 140 millions US$, et les exportations de 227 millions US$. Agriculture Le climat mauritanien est austère à l'agriculture. Moins de 1 % des terres est propice aux cultures. En 1997, l'agriculture mauritanienne a contribué pour 6 % au PIB alors que l'élevage en représentait 14,2 %. Les principales cultures céréalières sont le riz, le mil et le sorgho qui, en 1996, occupaient 95 % des terres. Le maïs et le niébé se sont beaucoup développés ces dernières années. Selon les années, la production céréalière varie d'environ 100 000 tonnes (1990-91 à 1992-93) à environ 200 000 tonnes (1994-95 et 1998-99). Les cultures irriguées concernent surtout le riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Les terres arables sont situées dans les zones sahélienne et surtout soudanienne (bordée par le fleuve Sénégal) qui est la plus peuplée et qui fournit l'essentiel de la production céréalière. Les importations céréalières, avec une moyenne d'environ 280 000 tonnes/an durant les années 90, excèdent très largement les exportations céréalières (moyenne d'environ 25 000 tonnes/an sur la même période). Situation alimentaire Le pays est loin de l'autosuffisance alimentaire et doit recourir à des aides massives en période de sécheresse. L'évolution du taux d'autosuffisance des produits agricoles est le suivant :
Les disponibilités caloriques et protéiques ont progressé entre 1972 et 1992, passant de 1889 kcal/pers./jour et 70 g/pers./jour à 2684 kcal/pers./jour et 81 g/pers./jour, pour baisser ensuite légèrement et atteindre les valeurs respectives de 2 622 kcal/pers./jour et 74,1 g/pers./jour en 1997. En 1997, les céréales ont contribué pour 53 % aux disponibilités caloriques, et les huiles et graisses pour 10,7 % . CARTE D'IDENTITE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Copyright spkangni 2003 Conception et réalisation : Sylvain Patrice KANGNI